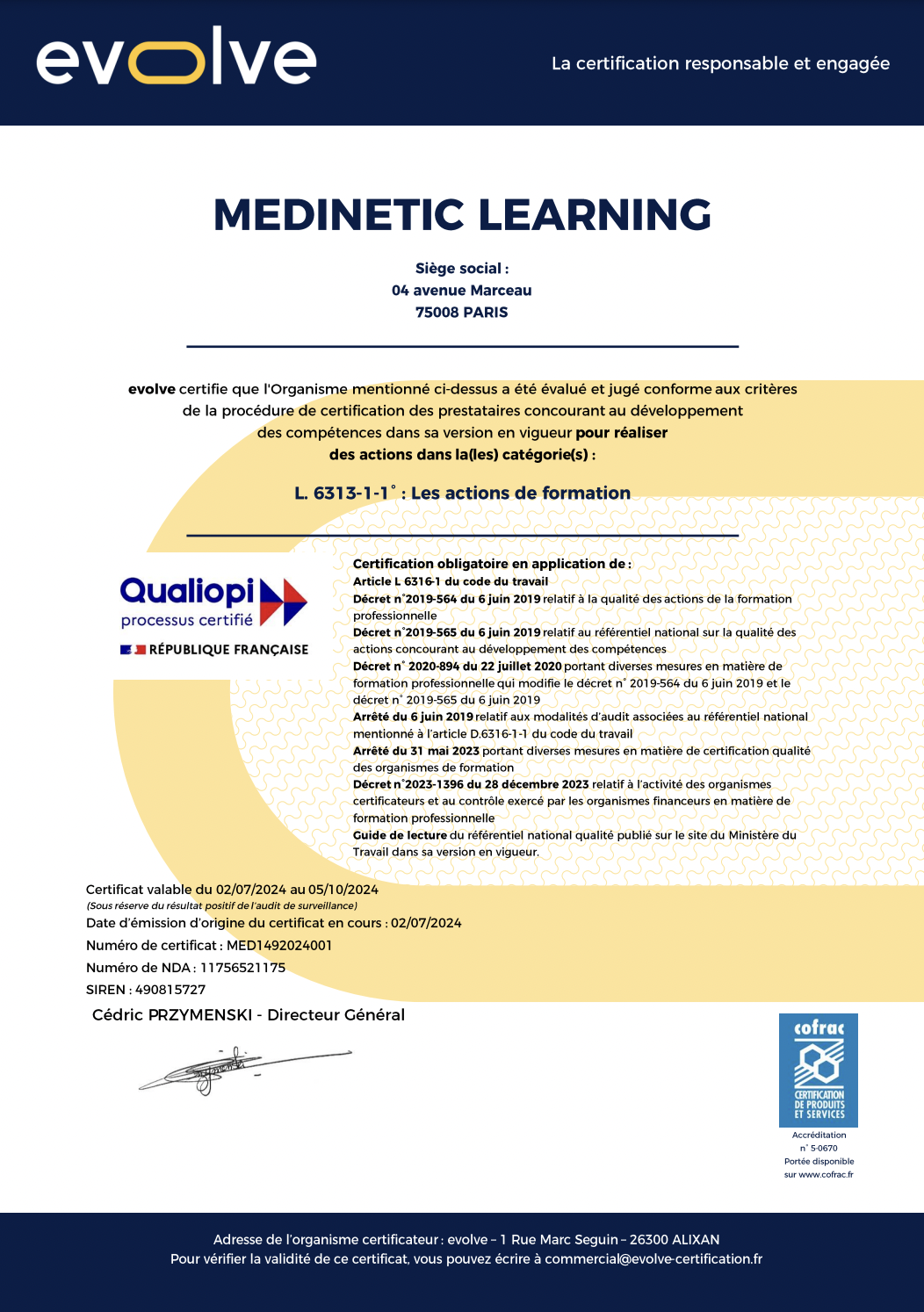La performance en sprint dépend d’une chaîne cinétique efficace et d’un équilibre fin entre production de force, cadence de jambe et contrôle tronculaire. L’imagerie T2-MRI apporte une mesure indirecte de l’activité métabolique musculaire post-effort, utile pour identifier les groupes musculaires les plus sollicités lors d’efforts explosifs. Comprendre quelles structures sont majoritairement engagées permet d’ordonner la prise en charge rééducative et d’optimiser la restitution fonctionnelle vers des sprints sûrs et performants.
Des sprinters entraînés ont réalisé un protocole de sprints courts mais intenses (trois séries de trois allers-retours de 60 m avec récupérations courtes). Des acquisitions T2 ont été réalisées avant l’effort et dans les minutes qui suivent pour 14 muscles du bassin et du tronc. La variation relative du signal T2 (pré → post) sert d’estimateur d’activation métabolique globale, y compris pour les muscles profonds difficilement explorables par EMG de surface. Le protocole est conçu pour capter l’engagement global immédiat, mais reste limité par la taille d’échantillon et le timing post-effort.
Les augmentations relatives de signal T2 les plus marquées ont été observées pour :
- Gluteus maximus — augmentation la plus importante : rôle central dans la propulsion horizontale et la production de moment d’extension de hanche.
- Lateral abdominals (obliques/transverse) — forte activation : stabilité anti-rotation et transmission de force.
- Pectineus & psoas major — sollicitations élevées : contribution à la flexion de hanche rapide et au repositionnement de la jambe.
- Erector spinae — engagement important : maintien de l’alignement rachidien en appui et résistance à la flexion en haute vitesse.
la victoire du pattern moteur réside dans une combinaison de puissance de hanche (gluteus maximus), capacité de repositionnement (psoas/pectineus) et contrôle tronculaire en rotation/flexion (obliques, érecteurs). Le signal T2 traduit l’intensité métabolique — donc la fatigue potentielle et la priorité de renforcement/conditionnement.
1. Priorité 1 — Production de force horizontale (gluteus maximus)
- Objectif : restaurer la capacité d’extension explosive et la tolérance à charges répétées.
- Modalités : activation neuromusculaire → force maximale → puissance (hip thrust lourd → hip thrust explosif → sled pushes → sprints progressifs).
2. Priorité 2 — Repositionnement et cadence (psoas, pectineus)
- Objectif : améliorer la vitesse de flexion de hanche et la répétabilité du cycle de jambe.
- Modalités : renforcement progressif du fléchisseur de hanche (leg raises progressifs, resisted marches, high-knee drills) avec contrôle lombopelvien.
3. Priorité 3 — Stabilité tronculaire dynamique (obliques / erector spinae)
- Objectif : maintenir transmission de force sans pertes par rotation ou flexion incontrôlée.
- Modalités : anti-rotation (Pallof press), exercices d’endurance-force pour les érecteurs et drills en charge unilatérale.
Ces priorités doivent être intégrées dans une progression logique : activation → force → puissance → transfert spécifique (sprint), en contrôlant la qualité technique à chaque étape.
Principes généraux
- Fréquence : 3 séances ciblées/semaine + sessions complémentaires (technique, mobilité).
- Progression fondée sur critères fonctionnels et non sur semaines fixes uniquement.
- Mesures de suivi régulières : asynchronie puissance/force, asymétries <10–15 %, absence de douleur en sprint progressif.
Semaine 1–2 — Activation & contrôle
- Activation gluteus (ponts unilatéraux, squeezes 3×30s), Pallof press 3×8/side, hollow hold/leg raises isométriques.
- Drills technique légers (A-skips, marches dynamiques).
Semaine 3–5 — Force ciblée
- Hip thrust 3–4×4–6 (charge lourde), single-leg RDL 3×6, deadlift (technique) 3×4.
- Weighted leg raises 3×8, back extension 3×8.
Semaine 6–8 — Puissance et transfert
- Hip thrust explosif 4×6, sled pushes/sprints resistés 4–6×20–30 m, bounds/bonds 4×6.
- Sprints courts répétés (10–40 m) avec récupération complète pour travailler qualité de poussée.
- Critères d’avancement : asymétrie CMJ <10 %, force isométrique hanche équilibrée, technique de sprint préservée en fatigue.
- Force isométrique hanche (handheld dynamometer) : extension & flexion.
- Single-leg CMJ / hop test : mesurer asymétries.
- Sprint 10 m & 30 m : vitesse d’accélération et vitesse maximale.
- Pallof hold / front plank time : endurance tronculaire.
- Utiliser ces tests toutes les 2–3 semaines pour ajuster charge, intensité et orientation des exercices.
- Population : échantillon restreint, hommes sprinters — prudence de généralisation aux femmes, amateurs, sports avec autres biomécaniques.
- Nature du signal T2 : indicateur d’activation métabolique post-effort, pas mesure directe de force ni de timing précis pendant la course.
- Timing des acquisitions : la fenêtre post-effort peut intégrer des effets de perfusion et métabolites ; interpréter avec nuance.
- Application clinique : l’imagerie éclaire les priorités mais ne remplace pas l’évaluation clinique et fonctionnelle individuelle.